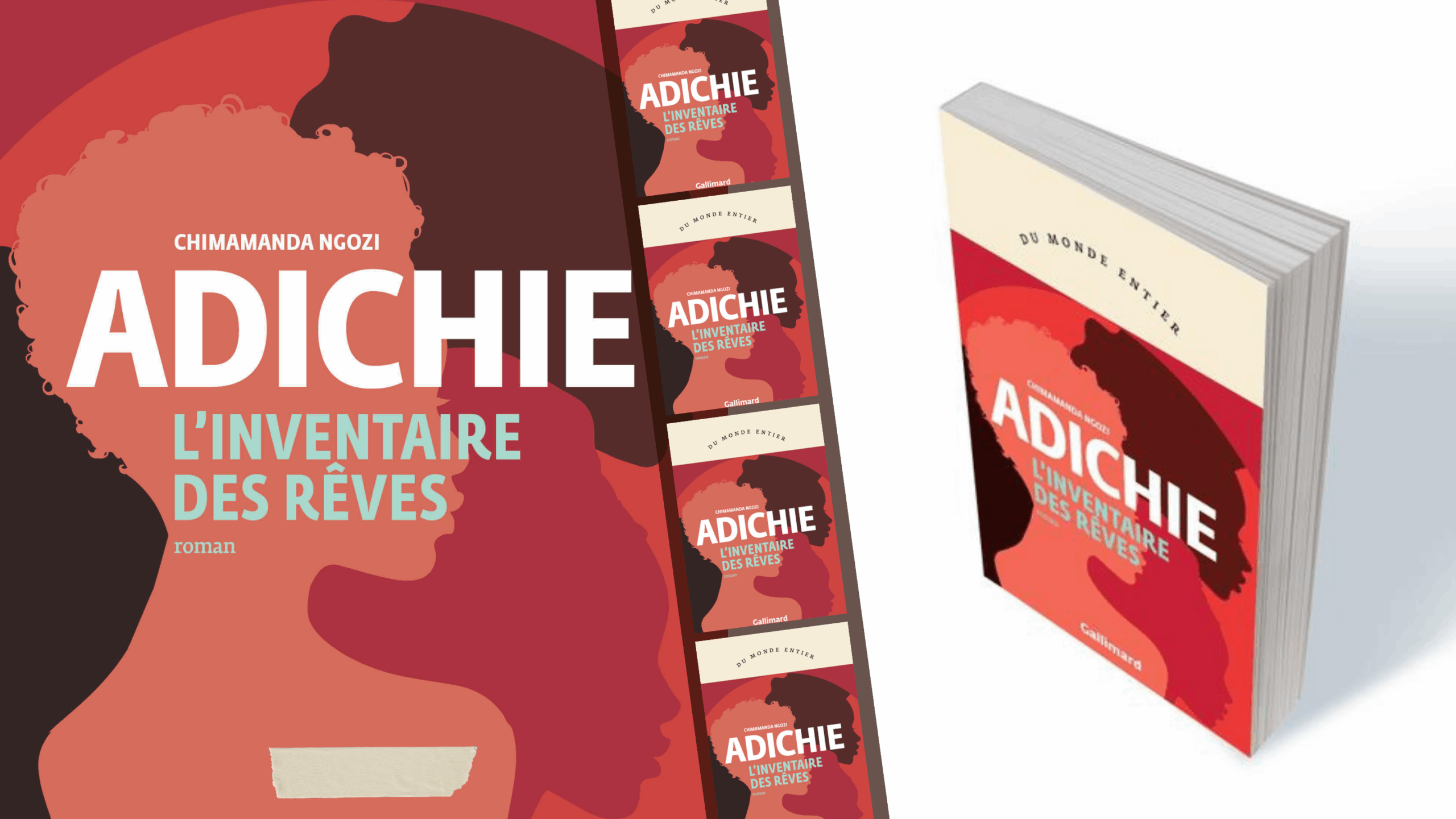L’inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie… Une traversée des voix, entre liens invisibles et rêves inégaux.
Je suis entrée dans ce livre comme on entre dans une pièce peu éclairée, curieuse, prudente, sans m’attendre à ce que ces quatre femmes me tendent un miroir aussi brut. Au fil des pages, j’ai reconnu des ombres familières, j’ai éprouvé des colères sans réponse, des silences trop lourds, et des renoncements à peine formulés. Mais surtout, j’ai ressenti cette tension sous-jacente : celle d’un rêve qu’on n’ose pas toujours avouer, parce qu’il coûte trop cher ou semble hors de portée.
Chiamaka:Des rêves d’amour
C’est la voix qu’on entend d’abord. Elle ouvre le livre comme on ouvre un tiroir oublié, avec la précision d’une femme qui a trop longtemps vécu dans le flou. Elle m’a d’abord fascinée par son intelligence, son analyse fine de tout, y compris d’elle-même. Mais très vite, elle m’a troublée par ses failles, et surtout par ce que sa relation avec Darnell a révélé : une femme brillante, lucide, et pourtant restée trois ans avec un homme qui n’en valait pas la peine.
« Je voulais de l’amour, une histoire d’amour traditionnelle. Je voulais que mes rêves et les siens s’accordent. Que nous soyons fidèles, que nous découvrions nos moi véritables, que nous nous disputions et soyons brièvement privés l’un de l’autre, toujours conscients que la douceur de la réconciliation ne serait jamais loin. Mais cette idée de l’amour était banale, affirmait-il, le fruit des récits mièvres et bourgeois dont Hollywood abreuvait les gens depuis des années. Il voulait que je sois insolite, intéressante, et il me fallut du temps pour comprendre ce que cela signifiait.
Plus tard, elle nous fait découvrir sa relation avec Chuka… Ah la la ! Sans spoiler, j’emprunte ses mots pour la résumer sa vérité : « j’avais rompu avec Chuka car je n’arrivais plus à ignorer la douleur exquise de vouloir aimer quelqu’un d’adorable que l’on n’aime pas. ». Si au fil de son introspection, Chia nous révèle d’autres relations, c’est cette dernière qui m’a le plus interpelé.
Et moi, je suis restée là, à me demander si on apprend vraiment à aimer mieux, ou si on apprend juste à renoncer autrement.
Zikora:Des rêves traditionnels
Elle m’a bouleversée par l’injustice qu’elle a traversée. Ce que Kwame lui a fait… Non, je ne comprends toujours pas. Un homme adulte, cultivé, qui la laisse seule dans un moment aussi vulnérable. Innommable. Pourtant, c’est dans cette douleur qu’une brèche s’est ouverte entre Zikora et sa mère — et c’est ce moment que je n’oublierai pas. Parce que cette pudeur si africaine, ce silence générationnel, a cédé. C’est ce que j’ai ressenti dans ce lien entre mère et fille. Cette parole que seule la douleur a pu libérer.
« Si elle avait envie d’un joli collier, de vacances ou d’un bel appartement, il lui suffisait de sortir sa carte de crédit, mais son désir le plus sincère, son désir de mariage, dépendait de quelqu’un d’autre.
Kadiatou : Des rêves ordinaires
La plus sombre. La plus silencieuse. Celle dont je n’ai pas su parler tout de suite. Elle est partie de si loin. La mine. L’excision. L’absence de rêve. Elle n’était pas destinée à partir. C’était Binta, la sœur, l’ambitieuse, la flamboyante. Et pourtant, c’est Kadiatou qu’on retrouve femme de chambre dans un palace de Washington. Et c’est à travers elle que j’ai compris à quel point le rêve est une question de classe. Ce que Chiamaka, Zikora ou Omelogor vivent comme des étapes naturelles, Kadiatou l’imagine à peine.
« Une autre fois, Omelogor lui demanda : « Kadi, quel est votre rêve ?
— Mon rêve ? » Elle n’était pas certaine de bien saisir.
« Oui, si vous aviez le choix, que voudriez-vous faire de votre vie ? »
Kadiatou songea que seuls les gens oisifs étaient capables de se poser ce genre de question. Elle haussa les épaules. « J’adore mon travail. Je suis très heureuse de venir dans ce pays, comme ça Binta peut avoir ce pays.
Omelogor : Des rêves de pouvoir et d’influence?
La plus opaque. Celle que j’ai eu du mal à cerner. Peut-être parce qu’elle a mis des mots sur ce que les autres taisaient. Parce qu’elle vit pour donner, aider, soigner — et pourtant, elle se demande encore ce qu’il lui manque. Cette conversation sur l’adoption, ce malaise à l’idée de ne pas avoir d’enfant, cette manière d’aimer Hauwa… On aurait pu croire qu’une romance allait naître, mais non. Ce n’est pas le style de Chimamanda. Elle effleure. Elle suggère. Et Omelogor reste une énigme.
« Ces paroles m’ont transpercée, se sont ancrées en moi, blessantes. Ne fais pas semblant d’aimer la vie que tu mènes.
À la fin du livre, j’ai ressenti un sentiment d’inachevé. Pas de frustration, non, mais ce frisson d’un inventaire qu’on n’a pas fini de dresser. Parce qu’aucune de ces femmes ne clôt son histoire. Elles continuent de chercher, de douter, de rêver — parfois malgré elles. Et moi, je suis sortie du livre comme on referme un carnet dont certaines pages sont restées blanches. Volontairement. Comme pour me dire : toi aussi, écris la suite.
Est-ce un livre que je recommande ? Oui. Mais pas pour se divertir. Pour écouter. Pour mesurer l’inégalité des rêves. Aussi, pour comprendre que certaines vies commencent là où d’autres s’achèvent. Et pour se rappeler que nos attentes, nos colères, nos absences ne sont jamais isolées : elles font partie d’un grand récit, encore en cours d’écriture…